Mettre des mots sur les maux
par Parole de Médiateurs · 7 juillet 2025

La Commission reconnaissance et réparation (CRR) a été créée pour rendre justice aux personnes victimes de violences sexuelles, présumées commises par des membres d’instituts religieux. Antoine Garapon nous en explique la démarche.
La CRR construit une nouvelle forme de justice restaurative pour des faits très anciens, prescrits, dont les auteurs suspectés sont, la plupart du temps, décédés. En d’autres termes, il lui faut trouver des moyens pour réparer l’irréparable. Pour cela, elle doit considérer davantage les personnes que les faits, se concentrer sur leur être plutôt que sur l’avoir vers lequel, jusqu’à présent, toute notre compréhension de la justice a été tournée, priorisant la quantification du dommage ou de la peine.
La justice restaurative ne doit pas être comprise comme un pis-aller devant l’impossibilité d’avoir recours à la justice pénale ordinaire. Elle cherche une autre voie qu’une équivalence monétaire ou que l’incarcération du coupable. Parce que la victime d’une agression sexuelle se sent remise en cause au plus profond d’elle-même, elle n’attend pas seulement de la justice des “dommages et intérêts” ou une peine de prison, mais demande à être restaurée dans son être – tel est le sens de la reconnaissance. Son rétablissement est donc le principal enjeu : revenir sur le passé, mais pour ouvrir sur un avenir.
Sortir du silence
Le délai moyen de silence intérieur des victimes de viol commis par des religieux est d’environ 35/40 ans. Cela donne des vies consumées dans la dévastation et le désespoir intérieurs. Ce silence n’est jamais uniquement lié à une incapacité de parler ou au fait du secret. Il provient d’abord de l’impossibilité de se formuler à soi-même l’origine de son mal-être. Ensuite, lorsque la victime arrive à mieux comprendre ce qu’il s’est passé dans sa vie, elle se heurte souvent à une négation de sa parole, au fait de ne pas être crue. Cette négation, ce silence, sont redoublés par ceux de l’institution et, au-delà, de la société tout entière. Le monde continue de tourner en reposant sur un immense mensonge. Telle est la réalité la plus extraordinairement choquante à laquelle ces affaires nous obligent à faire face : ces faits, qui se sont produits en très grand nombre pendant des dizaines d’années, ne constituaient pas un événement pour l’Église, ni plus largement pour l’espace social.
Cela, on ne peut le tolérer, mais on peut l’expliquer. Reconnaître cette réalité revient à accepter un scandale insupportable pour certains : le fait qu’une entreprise morale comme l’Église damne au lieu de sauver, sème la mort en annonçant la vie et dévaste des êtres à qui elle promettait le salut. Le plus choquant, c’est précisément que cela ne choque pas, ni au sein de cette communauté, ni plus largement dans l’espace social. Cela nous avait frappés lors des travaux de la CIASE (1) : nombreux sont ceux préférant le mensonge pour leur sécurité morale personnelle !
Cela engendre des situations très difficiles, notamment quand les victimes recouvrent la mémoire et demandent à la justice d’agir alors que ces affaires sont prescrites depuis longtemps et que les faits vont être extrêmement difficiles à prouver. Les raisons d’une prise de parole si tardive et de l’échec de la justice ordinaire tiennent à la fois à la pression sociale, qui rendait peu audible la mise en cause de religieux, aux biais cognitifs de l’institution judiciaire, mais également à une forclusion intérieure des victimes qui se sentaient honteuses et coupables.
Libérer la parole
La démarche de la victime est éminemment intime, et donc non-délégable, car elle concerne le rapport à soi, à son corps comme médiation avec le monde. On a trop parlé à sa place, elle s’est trop longtemps tue, elle a souffert toute sa vie d’inhibition, d’une passivité mortifère. À présent, elle veut prendre la parole en personne, pas par l’intermédiaire d’un avocat (même si ce dernier peut l’aider en l’orientant vers la Commission reconnaissance et réparation). Les victimes de viols ou d’abus sexuels ne supportent plus que des professionnels, même les mieux intentionnés, imposent leurs catégories, leurs mots. C’est pourquoi tout le processus de la CRR est fondé sur le projet de restituer à la victime la parole, une parole qui doit faire événement pour celui qui la profère et pour l’institution à laquelle appartenait l’auteur. Elle met au grand jour ce qui avait été passé sous silence. Ceci constitue déjà, en soi, un travail de justice.
Aussi, tout le processus est fondé sur l’ambition de restituer la parole à la victime. On constate très souvent combien ce point est central, comme lorsqu’une victime s’émeut de voir ses propos repris expressis verbis dans une recommandation de la CRR : “Non seulement on me croit, mais on porte crédit à mes propres mots.” (sous-entendu, “et pas à ceux de la police ou de mon avocat, voire de mon psy”).
La parole doit faire événement pour celui qui la profère et pour l’institution à laquelle appartenait l’auteur, révéler au grand jour ce qui était resté sous les radars. Le but est donc de dramatiser – au sens de Georges Politzer (2), à savoir d’une dramatisation sociale – des faits passés et de leur redonner toute leur dimension. Il s’agit d’une sorte de mise en scène du crime – sous sa vraie qualification – par les mots, pour lui conférer de la chair sociale, mais dans le cadre d’une rencontre apaisée avec des représentants de l’institution à laquelle appartenait l’auteur.
L’objectif que poursuit la CRR est d’organiser le milieu le plus favorable à une “parole parlante”, pour reprendre la distinction de Merleau-Ponty. Cela ne congédie pas le traumatisme, mais permet de le surmonter (verbe capital déjà employé par Jean Améry, juif torturé puis déporté lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a écrit l’un des livres les plus profonds sur le traumatisme moral) (3), de le dépasser, de ne pas y rester arrimé, de recommencer à vivre “en dépit de”. Ces échanges permettent aussi de retracer une continuité à travers le récit de sa vie comme une totalité signifiante et ouverte, de pouvoir parler autrement de soi, de se désigner autrement. Passer de victime à témoin de soi-même.
Ouvrir de nouveau le temps
Pour les victimes, le temps s’est arrêté au moment de l’agression. Elles ont vécu après, mais à côté de leur vie. “J’ai fait semblant d’aimer. En réalité, ma vie, ma vie sexuelle, sentimentale, tout s’est arrêté à douze ans. Après, c’était de la survie, des stratégies de protection pour que l’on me touche le moins possible et pour qu’on ne voie pas qu’en fait, j’ai été totalement incapable d’aimer, de faire confiance. Il me fallait vivre avec cet enfant mort en moi.”
La justice ordinaire se concentre sur le passé. La réparation, telle que nous l’entendons à la CRR, vise l’avenir : reconstruire une personne, lui permettre de retrouver l’énergie de vivre, le courage d’exister. Le modèle classique de la justice repose implicitement sur l’idée d’un ordre antérieur à réaffirmer, d’un équilibre entre les droits de chacun. Notre approche est de replacer le centre de gravité d’une vie devant et non plus derrière la victime.
L’objectif de la justice restaurative est moins de trouver les bonnes équivalences au préjudice ou au crime que de relancer le temps, de l’ouvrir de nouveau, afin de permettre qu’une parole déployée ait non seulement un véritable impact, mais aussi qu’elle referme un épisode douloureux et toujours vif. À la fin du processus, beaucoup confirment l’impression d’avoir renoué avec le temps, d’avoir recouvré la capacité de regarder l’avenir sans être “plombé” par le passé.
Réparer
Comment réparer l’irréparable, une vie dévastée ? La CRR établit une distinction nette entre réparation et indemnisation. Elle propose à la personne victime un document sous forme de double questionnaire. Dans le premier, sont précisés les abus, les circonstances, les éléments les plus factuels. Le second est rempli par la victime qui évaluera elle-même, comme on note sa douleur dans les hôpitaux, l’impact de l’agression sur sa vie, et ce, du point de vue de son intimité – les phobies, les TOC, les envies de suicide, l’anorexie, l’impossibilité d’être touché, la dyslexie, toute une série de symptômes propres au tableau de victimes d’abus sexuel, puis les conséquences négatives sur sa vie affective et familiale.
Viennent ensuite la vie sociale et professionnelle et enfin, la vie spirituelle. Car la foi des personnes victimes d’abus commis au sein de l’Église peut être gravement affectée. Les vœux religieux se caractérisent par leur radicalité, ce qui explique que l’agression détruit à hauteur de l’engagement, c’est-à-dire radicalement. Elle aboutit à un ébranlement métaphysique. Il y a donc un préjudice spirituel. Encore une fois, le viol est plus qu’une agression physique, c’est la destruction de la continuité espérée d’une vie – pas dans le sens de ses rêves (nous en avons tous), mais d’un parcours conforme à ses capacités (nombre d’enfants abusés ont vu leurs résultats scolaires s’effondrer après l’agression…), de la vie considérée non comme projet, mais comme aptitude à en former un.
Clôturer la démarche
Ce processus se termine par une clôture symbolique du temps. La CRR organise des journées de mémoire et d’apaisement mutuel. Au cours de ces événements, la parole des victimes peut être portée par la lecture de témoignages devant les religieux de la communauté. Puis la parole est donnée à la congrégation qui explique ce qu’elle n’avait pas compris et pourquoi, ainsi que ce qu’elle fait aujourd’hui pour que cela ne se reproduise plus. Enfin, le supérieur lit solennellement un acte de reconnaissance précis et circonstancié des faits et des manquements de la congrégation.
Il faut inventer collectivement des gestes symboliques comme revenir sur les lieux, la remise d’un acte formel de reconnaissance de la part des congrégations, la plantation d’un arbre, la remise de cadeaux (un stylo pour écrire sa vie, par exemple). L’écriture est peut-être la forme la plus complète et durable de réparation.
Le tout se termine par un moment convivial. Les victimes sortent le plus souvent réconfortées quand elles constatent que telle congrégation, qui avait refusé de les écouter, s’est remise en question, que leur témoignage a été véritablement performatif.
J’insiste sur un point essentiel, particulièrement quand l’institution en question est l’Église, mais cela vaut, à vrai dire, pour tous les dispositifs de justice réparatrice : le vocabulaire du pardon n’a pas sa place dans cet espace de parole. Il ne doit pas être la finalité, ni même avoir de place officielle. Cela a été posé d’emblée, car le pardon peut être une manière d’annuler l’événement, d’imposer une sorte de loi d’amnistie spirituelle. Un pardon prématuré, voire extorqué, peut faire des ravages chez les victimes.
Créer un avant et un après
La justice restaurative vise à mettre un terme au temps immobile du silence, au temps mort et mortifère du trauma, et à le faire basculer, par une parole refondatrice, vers un temps “rendu disponible à du nouveau”, ce qu’Emmanuel Levinas (4) appelle, avec une remarquable pertinence, “le temps infini de la fécondité”. Cela n’est possible que par la reconnaissance sociale des faits.
Les récits des personnes entendues par la CRR n’ont pas été crus parce qu’ils n’étaient ni pensables, ni imaginables. Il apparaît donc crucial que la justice étudie également les représentations sociales et institutionnelles qui provoquaient cette censure de la parole, et qu’elle se penche sur son accueil et sur les clichés ayant généré un tel aveuglement et une culture du silence et de l’enfermement pour les victimes.
Le rôle de tiers de la CRR et la façon dont elle se place par rapport aux victimes d’une part, aux auteurs et aux institutions d’autre part, est central. C’est sur ce tiers que repose toute cette justice. L’ambition de la Commission est d’ouvrir la voie à cette justice restaurative de nature civique. Par sa composition, elle est plurielle, même si elle intervient dans le milieu de l’Église catholique, et pourrait intéresser d’autres institutions comme le sport, la politique, la culture, voire l’université.
Une note d’espoir
Nous constatons que nombre de victimes retrouvent vie, referment une période de leur vie au terme du processus de la CRR. Cela confirme que l’enjeu est bien d’ordre existentiel, et non de l’ordre du soin ou de la consolation.
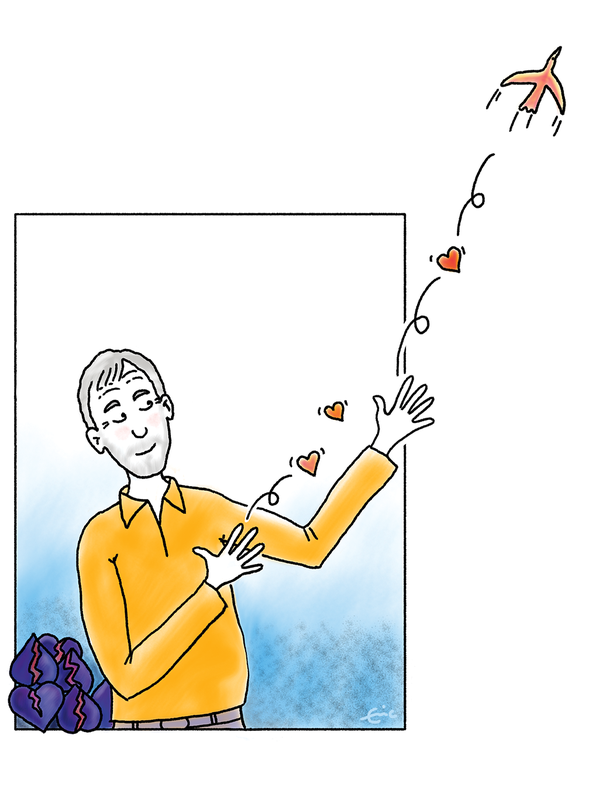

Antoine Garapon est magistrat honoraire.
Après avoir été juge des enfants, il enseigne aujourd’hui à l’école de droit de Sciences Po.
Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment : Des crimes que l’on ne peut ni pardonner, ni punir (éd. Odile Jacob, 2002), Peut-on réparer l’histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah (éd. Odile Jacob, 2008).
Antoine Garapon anime également l’émission hebdomadaire Esprit de justice sur France Culture. Il a été membre de la CIASE.
(1) CIASE : Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
(2) Georges Politzer : philosophe, résistant communiste et théoricien marxiste français d’origine hongroise.
(3) À lire : Par-delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable, Jean Améry, éd. Actes Sud, 2005, 224 p., 9,20 €.
(4) Emmanuel Levinas : philosophe français (1905-1995).




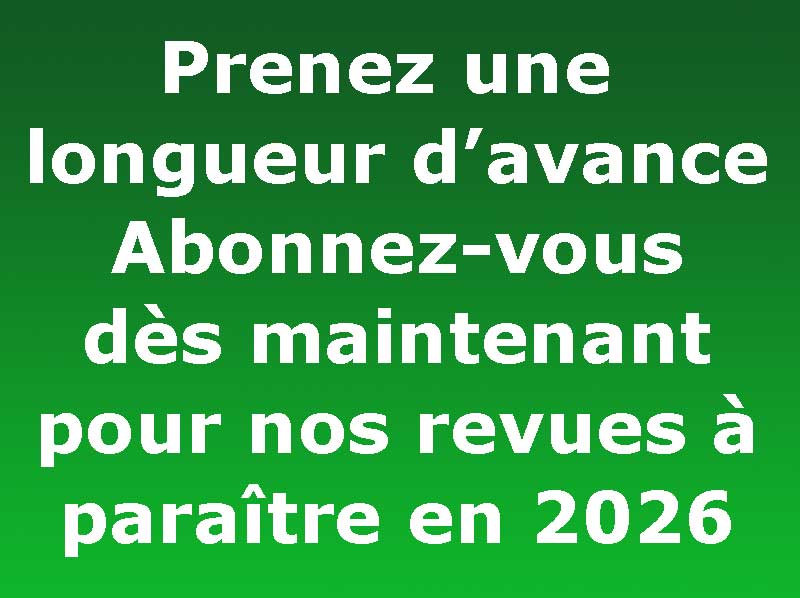




Vous devez être connecté pour poster un commentaire.